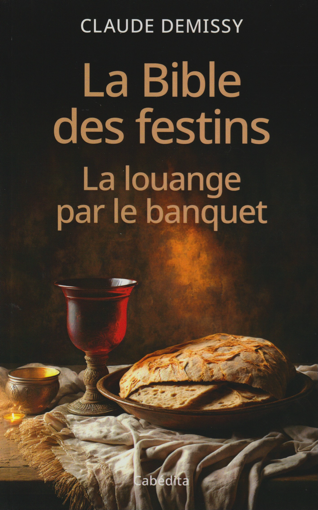
La louange par le banquet
Claude Demissy
96 pages – 15 €
Recension Gilles Castelnau
Le pasteur Claude Demissy s’appuie sur sa grande connaissance et son amour de la Bible pour nous introduire dans la spiritualité des anciens Hébreux et des disciples de Jésus. Il nous montre que leur vie quotidienne était marquée notamment par des repas – fort bien cuisinés – qui les mettait, comme nous évidemment, dans une relation mutuelle positive qui s’ouvrait aussi sur la présence de Dieu. Il insiste sur le fait que les « sacrifices », comme on dit, ne représentaient pas, à l’époque, un renoncement ascétique ni un rite d’expiation des péchés mais, bien au contraire, une communion festive avec Dieu vécue dans le cadre d’une alliance heureuse.
L’ensemble de cet excellent petit livre nous invite à une piété souriante et détendue capable de nous libérer de nos sentiments confus de culpabilité issus d’une théologie anxiogène.
En voici des passages.
LA CULTURE DU FESTIN
LES BANQUETS CONVIVIAUX
Le contraire d’un sacrifice
Il s’agit d’un banquet de communion, une forme très répandue de fête désignée à tort par le mot sacrifice. Ici le mot est vraiment mal employé puisque les hu mains ne se privent de rien. Bien au contraire, ils se partagent les mets, Dieu étant leur invité d’honneur. D’une manière générale, le banquet convivial prend la forme d’un repas partagé entre Dieu, les prêtres et l’assemblée. Ce repas unit les participants. Les partenaires mangent ensemble une même nourriture, image d’une communion parfaite.
LA TRADITION ORIENTALE DE L’ACCUEIL
Accueillir Dieu dans la tradition orientale
L’holocauste (Lévitique 1) constitue l’un de ces repas semblables à celui d’Abraham. Le mot vient du grec holokautôma. L’offrande est entièrement (holos) consumée (kaumatizô). Ici l’officiant brûle toute la nourriture pour l’offrir à Dieu. Cela correspond à la tradition orientale consistant à accueillir de cette manière un personnage à honorer. C’est la version liturgique de la coutume pratiquée par Abraham lorsqu’il accueille les trois personnages dans Genèse 18.
Dans ce rite, Dieu descend sur terre auprès des humains. Il ne s’agit pas de faire monter vers le ciel la matière cuisinée. C’est Dieu qui vient et uniquement pour bénir. Il ne s’agit pas de le nourrir pour assouvir sa faim. Il n’en a pas besoin. C’est un geste d’hospitalité. Les relations entre Dieu et les humains prennent la forme d’un repas dont Il est l’hôte de marque.
Le sens de cette pratique n’est pas de tuer un animal pour Dieu. C’est d’apprêter un festin à l’intention exclusive de l’invité : Dieu. Il s’agit de l’honorer. L’invitant ne prend pas part au repas, il est là pour se tenir à la disposition de son hôte comme dans Genèse 18,1-8, 1 Samuel 28,22-25 illustre également ce trait profond de la culture occidentale. Le roi Saül consulte une sorcière et se trouve mal. La dame lui offre un repas de luxe mais n’y participe pas.
Le mot sacrifice, une mauvaise traduction de l’hébreu
Le mot sacrifice est particulièrement malvenu pour traduire les pratiques cultuelles de l’Ancien Testament pour une raison fondamentale. Que le repas soit partagé entre toutes et tous ou uniquement offert à Dieu, il donne beaucoup de plaisir à celui ou à celle qui l’apprête. C’est en effet un grand bonheur de préparer de bonnes choses pour les offrir. Il n’est pas possible de nommer sacrifice une prestation procurant du plaisir à son réalisateur.
En tout cas, l’analyse des pratiques cultuelles renforce l’importance des repas dans la Bible. Les références aux agapes et, en particulier, à celles marquées par l’abondance, se retrouvent dans la plus grande partie des cultes vétérotestamentaires. Nous y trouvons à la fois le plaisir de faire bombance, mais également la satisfaction de préparer une cuisine de choix pour son hôte.
LA NOURRITURE POUR DECRIRE LE MONDE DE DIEU
La symbolique du lait et du miel
La Bible décrit la Terre promise comme le Pays où coulent le lait et le miel. Ce pays désigne le monde de Dieu, vu comme un lieu de bonheur. Dieu veut le bien de son peuple et cela se concrétise dans la nourriture.
« Le pain ne sera pas rationné » (Dt 8,9). Cette expression décrit une prospérité ordinaire où l’indispensable est assuré. L’image du lait et du miel va plus loin. Ajoutez du lait et du miel à votre recette de pain et vous obtiendrez un produit plus moelleux et davantage sucré. L’ancien Israël ne connaît pas le sucre. La douceur gustative provient du miel. Le pain en abondance permet de vivre, l’ajout de lait et de miel donne un mets plus agréable. Il ne s’agit pas de manger pour survivre mais d’avoir plus pour mener une vie réjouissante.
LA THEOLOGIE ALIMENTAIRE
LES ANIMAUX CHEZ LES PROTESTANTS
Albert Schweitzer est le premier théologien protestant se souciant du bien-être animal.
[…]
Théodore Monod est un biologiste du XXe siècle (1902-2000). C’est le naturaliste français le plus érudit concernant le désert.
[…]
Il s’agit des fondateurs d’une prise de conscience sur le statut théologique de l’animal. Pour approfondir cette éthique, il faudrait définir un droit de l’animal à vivre selon la vocation de son espèce. Aucun animal n’a pour vocation de fournir de hauts revenus à l’industrie agroalimentaire. Cette théologie prohibe l’élevage en batterie et les autres pratiques dénigrant le droit de l’animal à vivre selon ses besoins. Ce n’est pas de l’anthropomorphisme calquant sur l’animal les besoins humains. Il s’agit de leur permettre de vivre dans des conditions respectueuses de leur nature. Cette théologie reste balbutiante. Mais les pensées d’Albert Schweitzer ou de Théodore Monod en incarnent des exemples précurseurs.
DEUX UTOPIES ET UNE REALITE
Le péché apparaît pour la première fois au chapitre 4 du livre de la Genèse. La jalousie y cause le premier meurtre de l’histoire humaine. Deux frères offrent un repas de fête à Dieu. Chacun propose un plat issu de sa culture alimentaire : un animal pour le berger et des végétaux pour l’agriculteur. Il s’agit d’une fête pour accueillir Dieu, pas d’un cadeau fait à Dieu pour obtenir quelque chose en échange.
Dieu préfère la viande. Le végétarien devient jaloux et tue le carnivore. Ce récit est emblématique d’une première utopie portée par un courant vétérotestamentaire. Selon elle, Dieu accompagne le nomade, pauvre mais heureux. Malgré son existence précaire, il pérégrine librement et Dieu fait route avec lui.
L’UTOPIE DE LA LIBERTE, NOMADE ET CARNIVORE
Ici, l’auteur décrit Caïn, l’agriculteur, comme une personne égocentrique, jalouse et colérique. Le narrateur oppose à Caïn les vertus du berger : le sens de la précarité de l’existence qui est la marque même de la foi, la disponibilité à l’appel de Dieu, comme dans Genèse 12,6, le sens de la solidarité (Gn 14,13-16), la générosité (Genèse 14,21 à 24) ou encore l’hospitalité comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre (Gn 18,1-8).
Le berger, libre de toutes attaches, peut vivre aventure de Dieu dans la foi.
LA CUISINE, APPORT DES HUMAINS A LA CREATION
Dans le Deutéronome (4,28) les faux dieux, des statues fabriquées par les humains, ne voient pas, n’entendent pas, ne mangent pas et ne sentent pas. Dieu est à l’opposé de cette inertie. Lorsqu’il participe à une fête offerte en son honneur, il mange, voit, entend et sent. Il ne s’agit pas de le nourrir afin qu’il reste en vie : c’est un geste d’hospitalité. Ainsi les relations entre Dieu et les humains prennent la forme d’un repas dont il est l’Hôte de marque. _
Tous les plats des festins cultuels sont cuisinés. Ainsi, Dieu et les humains collaborent. Dieu a créé un monde avec tout le nécessaire à la vie. Par son travail, en particulier la cuisine, l’humain crée à son tour. Il s’agit d’une activité théologique, pas seule ment du désir de faire plaisir à nos papilles. En effet, dans le Premier Testament, la manière de cuisiner les plats varie en fonction de la fête !
JESUS, UNE SPIRITUALITE SANS PRIVATIONS
PAS DE JEUNE POUR JESUS ET SES DISCIPLES
Les disciples de Jean-Baptiste demandent à Jésus pourquoi sa petite troupe ne jeûne pas. Jésus utilise une image : la noce symbolise la vie avec Dieu et Jésus s’abstient… de toute abstinence volontaire. Il annonce néanmoins des temps plus difficiles : l’époux leur sera enlevé (Mt 9,15). Les périodes de jeûne viennent d’elles-mêmes, la vie se charge de nous les offrir. Nul besoin de privations volontaires pour nourrir sa spiritualité. Jésus prône la joie de vivre.
BANNIR LES REGLES QUI EXCLUENT
Sa relation avec Matthieu (appelé Lévi chez Marc et Luc) commence par un repas. Or, à chaque fois, de farouches défenseurs de la bienséance religieuse fustigent certains convives. C’est tout aussi clair lorsque Jésus accueille une femme ayant une mauvaise réputation dans la ville (Lc 7) ou lorsqu’il mange chez un homme rejeté par la population (Lc 19). Les festins se doivent d’être des catalyseurs de convivialité et non des réunions de clans hostiles aux autres.
Laisser un commentaire