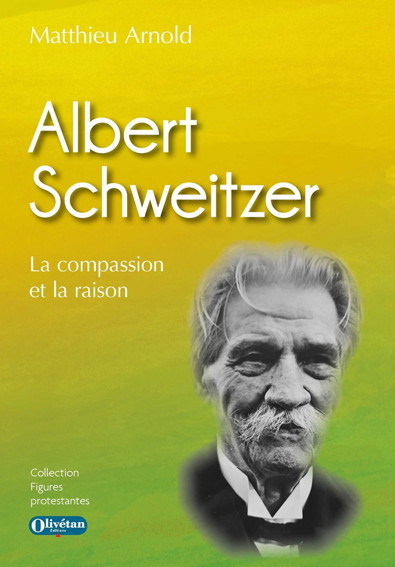
La compassion et la raison
Matthieu Arnold
professeur d’histoire du christianisme à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
136 pages – 15 €
Recension Gilles Castelnau
Le professeur Matthieu Arnold est un spécialiste d’Albert Schweitzer. Il a déjà écrit un ouvrage important à son sujet. Dans ce petit volume il réussit à nous faire survoler l’ensemble, avec relativement beaucoup de détails et de citations de ce qu’il faut en savoir :
Sa biographie depuis son enfance à Gunsbach, puis ses études dans la ville de Strasbourg germanisée depuis la défaite française de 1870, sa carrière prometteuse de professeur d’éthique et de théologie et de musicien organiste. Ses études de médecine le qualifiant pour servir les plus pauvres du Gabon et la construction de son hôpital. Ses voyages en Europe pour réunir l’argent nécessaire en donnant des conférences et des concerts. Sa maltraitance de la part des autorités françaises à cause de sa nationalité allemande évidemment sujette à caution durant les deux guerres mondiales.
Son étonnante réussite dans la création d’un hôpital respectueux des coutumes africaines, sa compréhension des peuples « de couleur », comme on disait à l’époque.
Sa réflexion théologique libérale fondée sur le « respect de la vie ».
Tout ceci donne vraiment à réfléchir et incite à renouveler les conceptions humaines et spirituelles qui en ont tant besoin aujourd’hui.
En voici quelques passages significatifs :
Chapitre 2
L’exégète du Nouveau Testament et le prédicateur : le Royaume de Dieu
L’exégète : retrouver Jésus et son message
Alors que les théologiens libéraux de son temps présentaient Jésus comme un maître de morale, affadissant les exigences radicales de son éthique, Schweitzer le tient à la fois pour le héraut du Royaume et pour celui avec lequel nous entrons en communion par l’action menée en son nom. Seuls ceux qui répondent à son appel,« Toi, suismoi ! », le connaîtront véritablement.
Le pasteur : exhorter à demeurer en Jésus et à œuvrer au Royaume par l’action
Lorsque Jésus et les premiers chrétiens parlaient du Royaume, ils attendaient son avènement de bouleversements provoqués par Dieu ; lorsque, au tournant entre le XIXe et le XXe siècles, les théologiens libéraux employaient cette notion, ils la confondaient peu ou prou avec le progrès moral de l’humanité. Dans ses prédications et dans ses écrits, Schweitzer comprend le Royaume comme une réalité à la fois présente (il se fonde notamment sur Luc 17.21), « Voici, le Royaume de Dieu est au milieu de vous ») et future (« Mais notre cité à nous est dans les cieux », Philippiens 3.20) : « Combien de temps encore jusqu’à ce que s’accomplisse partout le « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel » ? Nous ne serons plus là pour le voir. Et pourtant, il faut aller de l’avant. S’il n’est pas venu comme un éclair qui troue la couche des nuages [c’est-à dire : si le Royaume ne s’est pas accompli de la manière dont Jésus se le représentait], le Fils de l’Homme s’est levé sur le monde comme une douce lumière tranquille. Et marcher, combattre, travailler pour lui dans cette lumière, n’est-ce pas un assez grand bonheur – et assez de force pour vivre ? Il leur dit une autre parabole : « Le Royaume du ciel est comparable à du levain » »
[…]
Schweitzer relève en outre que l’homme contemporain ne se représente plus, au contraire des premiers chrétiens, le Royaume comme une cité merveilleuse dans l’au-delà, mais aspire à ce que son monde change conformément au message de Jésus : « Mille ans ont passé, deux mille ans – et le Royaume de Dieu n’est toujours pas sur terre. Nous l’attendons encore, la question : quand le Royaume viendra-t-il ? Nous avons pourtant consenti à en rabattre, à nous montrer modestes : nous n’envisageons plus la venue d’un royaume surnaturel ni l’apparition d’une Jérusalem céleste, dont les portes seraient en perles et les fondations en pierres précieuses ; non, nous voudrions seulement que par la force de l’Évangile s’opère une transformation de l’état de la terre et des conditions humaines, que toute chose dans le monde s’accomplisse selon l’idéal chrétien… » Le Royaume de Dieu, dont les fondements sont la justice, l’humanité et la sincérité, est le fait que « l’Esprit de Jésus règne sur l’humanité » tout entière.
Schweitzer tient le Royaume pour le fruit de l’action humaine et de l’action divine ; Dieu donne sa bénédiction au labeur humain : « Par lui-même l’homme ne peut pas grand-chose pour le royaume de Dieu. Mais ce peu qu’il réalise, même s’il croit que c’est en vain, la puissance de Dieu pourra s’y exercer et en tirer quelque chose de grand. »
Chapitre 4
Le philosophe du « respect de la vie »
« Nous naviguions lentement à contre-courant, cherchant notre voie, non sans peine, parmi les bancs de sable. C’était la saison sèche. Assis sur le pont d’une des remorques, indifférent à ce qui m’entourait, je faisais des efforts pour saisir cette notion élémentaire et universelle de l’éthique que ne nous livre aucune philosophie.
Noircissant page après page des phrases sans suite, je n’avais d’autre dessein que de fixer mon esprit sur ce problème dont la solution toujours se dérobait. Deux jours passèrent. Au soir du troisième, alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, en dispersant au passage une bande d’hippopotames, soudain m’apparurent, sans que je les eusse pressentis ou cherchés, les mots « Respect de la vie ». »
Des prédications éthiques
Dès ce sermon, Schweitzer s’attache à expliciter l’expression « respect de la vie ». Il s’agit pour lui du « commencement et du fondement de toute éthique », qui formule de manière positive l’interdit « Tu ne tueras point » : « Je ne peux m’empêcher de respecter tout ce qui vit, je ne peux m’empêcher d’avoir de la compassion pour tout ce qui vit. » Il s’agit pour chaque être humain de prendre conscience que les vies qui l’entourent – les autres hommes, mais aussi les vies animales voire végétales – sont dignes qu’il prenne garde à elles. Schweitzer explicite encore le respect pour la vie par cette injonction : « Tu te sentiras solidaire de toute vie et tu la préserveras. »
[…]
Le 2 mars 1919, le troisième sermon consacré au respect de la vie et aux problèmes éthiques traite de la compassion pour les animaux, en se fondant sur Proverbes 12.10 : « Le juste a pitié de son bétail, mais le cœur des impies est dépourvu de miséricorde. »
Or, l’attention de Schweitzer à la souffrance animale a précédé de longue date cette prédication. Dès sa petite enfance, avant même qu’il entrât à l’école, il ajoutait tout bas, à la prière que sa mère prononçait avec lui, une intercession pour les animaux : « Bon Dieu, disais-je, protège et bénis tout ce qui respire; préserve du mal tous les êtres vivants et fais-les dormir en paix» On connaît aussi le célèbre épisode – qu’il rapporte dans les Souvenirs de mon enfance (1924) tout comme en chaire – des oiseaux qu’il effaroucha dans les vignes de Gunsbach alors qu’un camarade l’avait invité à venir tirer sur eux à l’aide d’une fronde.
La civilisation et l’éthique (1923)
« Le fait le plus élémentaire que saisisse la conscience de l’homme peut être exprimé ainsi : « Je suis vie qui veut vivre parmi d’autres vies qui veulent vivre »… », affirme-t-il encore. Ces propos contreviennent à l’expérience universelle, selon laquelle une existence ne survit parmi d’autres vies que dans l’opposition à ces dernières ; toutefois, dans la mesure où l’être humain prend conscience de la volonté de ces autresvies, se fait jour en lui « une aspiration à devenir universel et à [se] fondre dans l’Un ». « Avoir le respect de la vie, c’est être saisi par la volonté, infinie, insondable et propulsive qui est à la base de toute existence. »
[…]
Dès son premier séjour à Lambaréné, il lui a fallu protéger son poulailler et ses animaux domestiques contre les attaques des fourmis rouges, ou encore, en tant que médecin, éliminer les formes de vie que constituent les microbes de la maladie du sommeil. Aussi son éthique est-elle moins simple qu’il n’y paraît lorsqu’il écrit que le bien consiste à conserver la vie et le mal à la détruire ou à l’entraver. Le philosophe est aussiconscient que l’éthique du respect de la vie pourra en certains cas se décliner différemment en Afrique et en Europe : tuer des éléphants pour se nourrir ou pour protéger des plantations à Lambaréné ne saurait être mis sur le même plan que la chasse « sportive » en Europe.
Chapitre 5
Le « grand docteur blanc » :
les relations entre les européens et les africains
Les premières impressions africaines :
À l’Orée de la forêt vierge (1921)
A lire À l’Orée de la forêt vierge, Schweitzer a été conforté Dans son opinion sur la souffrance résultant de la crainte des fétiches et des féticheurs, et par conséquent dans sa vision de la mission comme devoir humanitaire de vaincre cette peur. Venu en Afrique pour soigner des Noirs, Schweitzer ne s’est pas intéressé à leurs croyances en tant qu’anthropologue, mais il a été sensible à leurs effets sur la santé physique et mentale des autochtones. Ainsi, dans des pages qui datent de juillet 1916, il présente le christianisme comme « la lumière qui brille dans les ténèbres de[s] angoisses » de l’indigène, car il « lui donne l’assurance qu’il n’est pas à la merci des esprits de la nature et de ses ancêtres, ni des fétiches, et que nul homme ne possède un pouvoir magique sur ses semblables, mais que seule la volonté divine règne dans le monde.
Laisser un commentaire